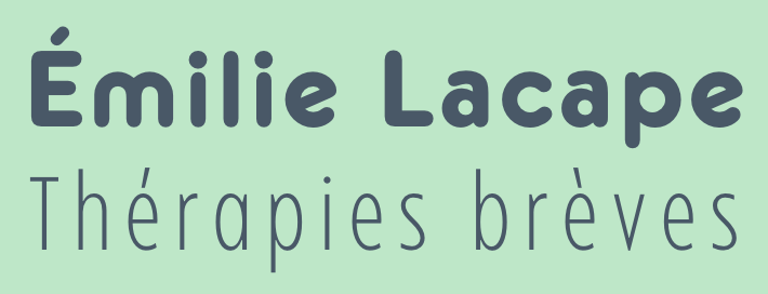Sortir de l'impasse avec l’approche systémique et stratégique
Quand on est coincé, on cherche souvent à comprendre POURQUOI il existe. Il est pourtant bien plus efficace de se demander COMMENT en sortir...
Emilie Lacape
10/7/20257 min read
Quand on se sent bloqué, on cherche souvent à comprendre pourquoi. Pourquoi on se retrouve là, pourquoi on est comme on est, pourquoi on ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'on fait. Pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas autrement...
Comme si comprendre pouvait suffire à changer. Or, qui n'a pas eu l'expérience très frustrante de trouver des explications satisfaisantes et convaincantes... sans pour autant parvenir à avancer ?
Si une jeune fille souffre d'un trouble du comportement alimentaire (TCA), on peut bien sûr se demander pourquoi. Les TCA étant des troubles complexes et multifactoriels, on sait qu'on trouvera des éléments de réponse dans son histoire personnelle, du côté d'éventuels prédispositions génétiques et biologiques, ou encore des éléments issus de son environnement familial et social... Mais pour cette jeune fille qui souffre, en quoi tout cela va l'aider à arrêter de se faire vomir ou de s'affamer ?
L’approche systémique et stratégique, issue des travaux de l’école de Palo Alto, propose un autre chemin. Cherchant à agir plus qu'à théoriser, on s'intéresse donc à la question du comment. En fait, c'est une approche très pragmatique de la thérapie. En se focalisant sur les manifestations présentes d'un problème, on observe la manière dont nous tentons de résoudre nos difficultés — pour pouvoir agir et provoquer un changement.
.
Le problème : une tentative de solution qui tourne en boucle
Faire plus… de la même chose
« J’ai tout essayé... tout ! Mais rien ne change. »
Cette phrase, je l’entends souvent en séance. Que ce soit une jeune fille qui lutte contre son anxiété, un couple qui cherche à "mieux communiquer" et finit par se disputer davantage, des parents qui s'arrachent les cheveux face à un enfant tyran...
Et si, au lieu d’en faire toujours plus, il s'agissait surtout de faire autrement ?
L’approche systémique et stratégique, développée dans les années 1960 à Palo Alto (Californie) par Gregory Bateson, Paul Watzlawick, John Weakland et Richard Fisch, repose sur une idée simple :
Ce qui maintient un problème n’est pas sa cause, mais la manière dont on tente de le résoudre.
Le problème, c'est la solution
Paul Watzlawick et ses collègues du Mental Research Institute l’ont montré dans leur ouvrage Changer, paradoxes et psychothérapie (1974) : ce qui bloque toute évolution, ce n’est pas l’absence d’effort, mais le fait de répéter les mêmes tentatives qui n'aident pas à solutionner le problème.
Prenons l’exemple d’une personne anxieuse :
Chaque fois qu’elle sent la tension monter, elle cherche à se calmer, à contrôler ses pensées, à vérifier que “tout va bien”. Mais plus elle fait tout cela, plus elle se montre à elle-même les signes que tout va mal, au contraire ! Ainsi, plus elle tente de maîtriser son angoisse, plus elle la nourrit. La tentative de contrôle devient le carburant du problème.
Trois grands types de tentatives de solution
Le contrôle – vouloir maîtriser ce qui échappe à notre volonté (les émotions, le désir, le sommeil).
L’évitement – fuir la difficulté, ce qui empêche d’en faire l’expérience autrement.
La mentalisation – chercher sans fin le “pourquoi” ou la solution parfaite, sans jamais passer à l’action.
Ainsi,
En thérapie individuelle, une personne veut “ne plus jamais être stressée” et se met une pression phénoménale… pour ne plus se mettre la pression.
En thérapie conjugale, un couple s’épuise à “tout se dire”, à être parfaitement transparent... au risque d'en dire trop et de créer encore plus de malentendus et de rancoeur.
En thérapie familiale, des parents surprotègent leur adolescent “fragile” : plus ils l'aident, plus ils lui montrent qu'il est faible, et plus il se sent impuissant.
C’est ce qu’on appelle la boucle systémique : chacun agit avec les meilleures intentions, mais renforce bien malgré soi la situation problématique.
Responsabilité : retrouver son pouvoir d’action
Responsabilité n’est pas culpabilité
Dans la vision systémique, la responsabilité n’est pas une faute, mais une marge de manoeuvre pour agir.
Paul Watzlawick (La réalité de la réalité, 1976) expliquait que nous construisons notre monde à travers nos interactions.
En ce sens, prendre conscience de notre responsabilité, c’est reconnaître que notre manière de réagir influence la situation — et que, par conséquent, nous avons le pouvoir de la faire évoluer.
Ce n’est pas “tout est de ma faute”, mais “je peux, à mon niveau, agir autrement”.
C’est une liberté, pas une charge.
Voir la boucle plutôt que le coupable
Dans un couple, le regard systémique invite à observer la danse relationnelle, c'est à dire la chaine de réactions de deux partenaires, plutôt qu’à désigner qui “a tort”.
Un partenaire silencieux face à la colère de l’autre peut, sans le vouloir, entretenir cette colère par son retrait.
Le problème n’est donc pas l’un ou l’autre, mais leur interaction répétée.
En famille, un adolescent en crise peut exprimer, par son comportement, une tension cachée entre ses parents.
Le thérapeute ne cherche pas un fautif : il aide chacun à voir le système tel qu'il (dys)fonctionne, et à reprendre la main en utilisant la marge de manoeuvre dont il dispose.
Changer ce qui dépend de soi
Changer un seul élément du système suffit souvent à faire bouger l’ensemble du système (interne, conjugal, familial).
Une mère qui décide d'arrêter de vérifier sans cesse si son fils a bien dormi envoie un message implicite : “Je te fais confiance.”
Un homme qui choisit d'arrêter de demander à sa partenaire de lui prouver qu'elle est fidèle lui permet d'arrêter d'agir en coupable.
Et c’est souvent là que les choses commencent à se transformer.
L’action : le cœur du changement stratégique
Les interventions paradoxales
Pour casser la logique du problème, un thérapeute systémique utilise parfois des tâches paradoxales, qui peuvent sembler étranges ou contraires au bon sens.
Giorgio Nardone, héritier de Palo Alto et fondateur du Centre de Thérapie Stratégique d’Arezzo, en a fait sa spécialité.
Ainsi avait-il donné à un patient insomniaque la consigne de “faire exprès de ne pas dormir”.
En cherchant à rester éveillé, le patient cesse (enfin) de tenter de se forcer à s'endormir... et finit par s’endormir naturellement.
Ce genre de prescriptions inattendues permettent au patient d'arrêter de faire ce qui ne les aide pas... et, en faisant autre chose, se donne la possibilité de vivre une expérience émotionnelle correctrice.
Expérimenter pour changer
Le changement ne naît pas de la seule compréhension (mentale), mais de l’expérience (sensorielle) d’une nouvelle manière de faire.
En thérapie de couple, un thérapeute peut proposer :
“Autorisez-vous une seule dispute par jour, de 18h à 18h15.”
Ce cadre, absurde en apparence, redonne de la légèreté et désamorce la spirale du conflit.
En thérapie familiale, un parent épuisé par les crises de son enfant peut recevoir la consigne de ne plus intervenir du tout pendant la crise.
Souvent, l’enfant, privé de son public habituel, se calme plus vite.
Le thérapeute comme metteur en scène du changement
Quand on est thérapeute stratégique, on n'a pas de baguette magique ni recette miracle qui conviendraient à tous et à toutes en fonction des problèmes rencontrés.
Quand on est thérapeute stratégique, on considère que chaque cas est unique. On étudie chaque situation pour comprendre quels sont les éléments du scénario répétitif qui mène au cercle vicieux ou à l'impasse, et on cherche l'élément le plus facile à modifier pour obtenir un résultat différent.
On construit avec la personne des expériences concrètes et mesurables, pour l’aider à sortir du blocage.
Notre rôle est de réintroduire du mouvement là où tout était bloqué.
De la souffrance à la souplesse : penser autrement
Dépathologiser le problème
Dans l’approche systémique, le symptôme n’est pas une anomalie, quelque chose d'anormal. C’est simplement une tentative d’adaptation qui ne fonctionne pas.
Une phobie, une colère, une inhibition sont des stratégies de survie qui, à un moment donné, ont eu du sens pour la personne. Et qui aujourd'hui peuvent ne plus lui convenir.
Le travail thérapeutique ne consiste pas à les juger, mais faire évoluer ces stratégies pour les adapter aux besoins actuels de la personne.
La flexibilité comme antidote
Watzlawick aimait citer cette phrase attribuée à Einstein :
“La folie, c’est de faire toujours la même chose et d’espérer un résultat différent.”
En fait, prendre ses responsabilités, c'est retrouver sa marge de manoeuvre... et tout simplement oser essayer autre chose.
Même un petit changement peut produire un grand effet.
L’humour comme stratégie thérapeutique
L’humour, très présent dans la tradition de Palo Alto, est un levier de souplesse. Quoi de mieux que de rire soudain de ses problèmes ?
L'humour permet de désamorcer la rigidité du problème et d’ouvrir un nouvel espace de liberté.
Ainsi, j'ai pu donner à une patiente perfectionniste la tâche de “faire volontairement mal un petit quelque chose, chaque jour”.
Cette consigne ludique crée un déplacement intérieur profond, en apprenant à s’autoriser l’imperfection.
Conclusion : de la boucle à la sortie
Changer, ce n’est pas tout comprendre de manière théorique.
C’est faire autrement — ne serait-ce qu’un peu ; pour s'autoriser à laisser advenir quelque chose de nouveau.
L’approche systémique et stratégique rappelle que le problème n’est pas toujours là où on le croit.
Ce qui entretient la souffrance, c’est souvent la façon dont nous voyons les choses, qui détermine la manière dont nous tentons de la résoudre.
En redonnant du sens à la responsabilité personnel (comme un pouvoir, pas comme une faute) et en privilégiant l’action stratégique, on retrouve une liberté de mouvement.
Alors, la prochaine fois que vous vous sentez coincé, demandez-vous simplement :
“Si je décidais de m'y prendre autrement que ce que j'ai fait jusqu'ici... qu'est-ce que je pourrais changer ?" Souvent, ce petit pas de côté est le début d'un changement.
Bien sûr, il n'est pas toujours évident d'avoir le recul suffisant pour comprendre ce qu'on répète à son insu. Chercher le regard éclairé d'un tiers peut faire partie du changement qui mènera à un résultat différent.
Pour en savoir plus
Paul Watzlawick, John Weakland & Richard Fisch – Changer, paradoxes et psychothérapie (Seuil, 1975)
Paul Watzlawick – La réalité de la réalité (Seuil, 1978)
Giorgio Nardone & Paul Watzlawick – L’art du changement (Seuil, 1990)
Giorgio Nardone – Peurs, panique, phobies (Seuil, 1997)
Gregory Bateson – Vers une écologie de l’esprit (Seuil, 1977)
© Emilie Lacape 2023